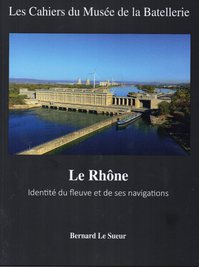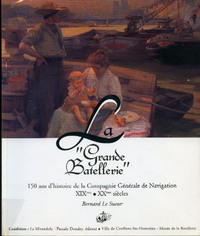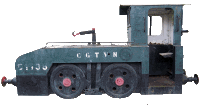Bon
Il était le plus doux des hommes. Jamais un mot plus haut que l’autre, toujours aimable, toujours attentif à votre propos et disposé à régler son pas sur le vôtre. Pour parler de lui avec la pudeur qui convient, il me faut disposer quelques voiles d’incertitude au plus intime du récit et préserver ces territoires où son âme demeure en paix. Vous ne connaîtrez pas son nom, en tous cas pas le vrai. Lorsque nous quittons une vie pour entrer dans une autre, tout est à refaire, c’est une renaissance. Quand il entra dans l’histoire qui s’ouvre maintenant, cet homme renaissant portait un nom nouveau qui évoquait parfaitement son amabilité.
Cet homme-là s’appelait Bon. Vous pensez déjà que ce n’est ni un nom ni un prénom, ce mot n’a même pas l’allure d’un sobriquet qui, pour parler juste, éviterait la monosyllabe.
Je dis que cet homme s’appelait Bon parce que c’est vrai. Après tout, il ne manque pas de Blanche, de Constant, de Prospère : pourquoi un homme ne s’appellerait-il pas Bon ? Rien que, seulement, uniquement Bon, sans aucun enjolivement. Bon tout court, c’est beau. C’est simple, c’est doux. C’est comme une bulle de gentillesse qui monte des profondeurs de l’existence et vient crever à la surface du quotidien en répandant un son très parfumé : “ ¤ Bon ¤ ”.
Ah, l’odeur de la bonté ! Rien à voir avec les relents de naphtaline de l’odeur de sainteté qui souvent masquent des remugles inavouables.
Comme la bouche parle de l’abondance du cœur, souvent le nom révèle un trait de caractère. Mon ami s’appelait Bon parce que si vous l’aviez rencontré de son vivant – je veux dire hors de cette histoire – vous auriez immanquablement pensé : “Comme cet homme est bon”.
Je choisis de parler de lui, parce qu’alors que sa vie allait tranquillement comme le courant du fleuve, elle se mua soudainement en torrent tumultueux. Une fois, une seule et unique petite fois, la bonté de Bon fut balayée par une colère mémorable. Elle vint comme un grain qui vous tombe dessus sans crier gare, qui vous gifle et vous laisse, quelques instants plus tard, stupéfait, debout sous le soleil et les pieds dans une flaque d’eau. Après, quand le calme revint, Bon reprit sa vie peinarde sans plus jamais faire d’éclat.
Vous comprenez déjà que cette fureur soudaine ne peut pas être son fait. Quand on est bon, on ne dispose pas en soi du matériel nécessaire pour ne pas l’être. Cette méchanceté doit forcément venir d’ailleurs. Le grain non plus, qui vous transperce tout à coup, ne peut se faire lui-même. C’est la rencontre incontrôlée de froidures arbitraires, de débordements torrides et toute l’eau du ciel qui tout à coup veut envahir la terre ! Tout serait parfaitement explicable si nous n’étions pas bornés au point de faire d’un phénomène atmosphérique prévisible un caprice du climat et d’une indignation compréhensible un accès de furie soudaine.
Mon ami était bon, pourtant pendant une infime fraction de sa vie, il sortit hors de lui comme une porte malmenée sort de ses gonds.
Bon vit le jour sur une péniche. C’était, un bateau de bois sans moteur avec un gouvernail imposant et une plage arrière – les bateliers disent les veules arrière – largement dégagée, dépourvue de marquise qui lui donnait une silhouette inimitable. Son père tenait cette unité de son grand-père qui l’avait fait construire par un baqueteux de Mortagne.
Bon avait fait ses premiers pas sur les écoutilles. Son père avait confectionné un petit harnais dotée d’une sorte de laisse terminée par un mousqueton qui glissait librement sur un câble tendu depuis l’arrière jusqu’au logement qui se trouvait au centre du bateau. Grâce à cet équipement, le petit derrière put expérimenter la loi de la gravitation universelle sans exposer le reste de l’anatomie du bambin aux périls de la rivière. Ce trotteur d’un genre un peu particulier eut aussi l’avantage d’ouvrir précocement son esprit aux premières manifestations de la douceur.
En dehors de sa lenteur qui la distingue de la navigation motorisée, la batellerie dite tractionnée avait un charme que nos cerveaux technologiques ont de la peine à concevoir : elle était silencieuse. Rien à bord, aucun mécanisme forcené ne s’entêtait à cogner pour clamer à la cantonade qu’il assurait l’avancement. Seul le bois des membrures gémissait lascivement sous les assauts du fleuve et l’enfant pouvait à l’envi s’imprégner du friselis de l’eau qui léchait les bordailles en même temps que des musiques vivifiantes du grand air. Aujourd’hui, depuis que le raffut des diesels étourdit de migraine l’acier des coques, ce silence habité n’est plus. On peut le regretter car, comme beaucoup d’enfants de mariniers, Bon trouva dans ses premières expériences une sérénité qui ne le quitta plus.
Dire que la péniche fut pour lui une seconde mère serait mentir. Sa mère biologique fut, il est vrai, un peu distante de cet enfant facile qui ne montrait pas d’intérêt pour les futilités dont raffolaient ses sœurs. Bon n’avait d’autre passion que le bateau et d’autre dieu que cette personne silencieuse et bienveillante qui conduisait leurs vies les jours à vide comme les jours en charge.
Ainsi était Constant, le père, qui fut, s’il en faut une, la seconde mère de Bon.
De lui, l’enfant garda cette façon d’agir sans faire d’esbroufe, cette manière de porter sur les épaules tout le poids de l’action en affichant un sourire plein de gratitude qui laisse aux autres le sentiment d’avoir mener la barque de main de maître. Constant était un homme combatif toujours en première ligne, jamais aux places d’honneur une fois l’engagement abouti. On le compta au nombre des membres fondateurs d’une coopérative qui apportait aux bateliers solidaires des conditions de remorquage avantageuses. Quand vint la rage de la grande guerre, quand, du côté de Diksmuide, la patrie se réduisit comme peau de chagrin, on le trouva encore l’arme au poing dans la première tranchée. De cette bravoure ordinaire, il ne tira aucune gloriole. Il y eut bien cette médaille qu’il ne porta jamais et puis le casque, percé par un éclat d’obus de septante sept, qu’il déposa sans autre commentaire sur le bahut de la cabine. De mots de guerre, de récits d’épouvante, d’éloges de l’atrocité, jamais la moindre trace. Personne non plus ne sut le fin mot de l’histoire de ces balles de 7’63 et du pistolet Moser qu’il ramena dans son paquetage quand l’hôpital militaire le rendit enfin aux siens. Cette arme allemande était, à n’en pas douter, celle d’un officier, mais Bon n’expliqua à personne comment elle était devenue sienne ni quel usage il avait pu en faire. Il l’enferma dans une boîte en fer qu’il planqua sur l’étagère la plus haute du buffet de cuisine.
– On ne sait jamais, se contenta-t-il de dire.
Quand Constant ouvrait la bouche, la seule confidence qui rappelait sa guerre était ce froissement de l’air que ses poumons ravagés gobaient avec toute la peine du monde. On avait mal pour lui. Pourtant, même aux pires moments de suffocation, Constant ne se déparait pas de ce léger sourire plein d’élégance qui étirait sa lèvre de côté sous la fine moustache. Bon, qui ne connut pourtant son père autrement que peinant à retrouver son souffle, se nourrissait de ce rayonnement et, petit à petit, sous les effets de l’empathie, la même illumination pleine de miséricorde apparut sur le visage du gamin et ne le quitta plus.
De la complicité de ces deux-là, je pourrais couvrir bien des pages, dire les gestes quotidiens cent fois montrés, cent fois refaits, les regards croisés de l’apprenti heureux et du maître ravi et, plus tard, la joie des retrouvailles quand la pension de Saint-Ghislain rendait pour deux mois l’aspirant batelier à sa famille.
Lorsque Bon retrouvait la péniche tout son être reprenait vie. Chaque cellule de son corps se réactivait dans l’accomplissement jubilatoire des tâches ordinaires. L’été avait sur Bon les effets du printemps. De façon singulière, ce surgissement de vitalité n’opérait pas sur la totalité de son individu : malgré l’allégresse du retour au bateau, le marinier en herbe s’obstinait à parler tout bas comme si planait toujours une mystérieuse menace. C’est que la discipline de l’institut laissait des traces. Le respect du silence était une règle stricte qui ne tolérait pas beaucoup d’exceptions : certainement pas durant la classe, non plus que dans les rangs sempiternels qu’il fallait former pour le moindre déplacement, ni durant les repas au réfectoire, ni le soir – c’eut été un comble – quand les enfants regagnaient les alcôves.
On imagine bien que pour une jeunesse pleine d’exubérante vigueur un tel effort n’est pas tenable. Aussi, pour ne pas s’immoler en martyrs consentants sur l’autel de la parfaite observance, les petits mariniers adoptaient-ils une manière de communiquer parfaitement discrète : tous les messages vocaux s’échangeaient sur un mode à peine perceptible pour l’oreille non-initiée. Les locuteurs les plus doués parvenaient même à émettre sans que rien sur leur visage ne les trahisse et les auditeurs affûtés étaient capables de lire sur les lèvres à la manière des sourds.
A toute chose malheur est bon. De ce pseudo-mutisme qui amusait son père, Bon garda l’habitude de parler avec retenu. Cette manière de faire conféra à sa voix un grain d’une grande douceur qui ravissait l’oreille. A aucun moment il ne devait forcer le ton tant était belle la musique des messages qu’il vous adressait. Sans être beau parleur, c’était un homme de parole, certes peu disert, mais qu’on prenait plaisir à écouter.
J’épingle ce détail parce qu’il permet de mieux appréhender la douceur qui émanait du personnage exceptionnellement aimable qu’était Bon. Pour le reste, il me faut m’en tenir aux faits qui, je le crois, expliquent tout d’eux-mêmes.
Voyant son fils si passionné par le métier et malgré sa santé précaire, Constant fit le pari d’abandonner le vieux bateau pour aller de l’avant. La guerre avait eu raison des vieilles habitudes et les charpentiers de marine avaient dû se reconvertir à la chaudronnerie pour construire des bateaux de fer. Constant et Bon, qui serait bientôt diplômé, ne rêvaient que de cela. Il était révolu le temps du calfatage, du goudronnage toujours recommencé : pour ces hommes exposés à toutes les facéties du climat, les coques rivetées avaient l’attrait de l’immortalité. On laissa donc le vieux bateau de bois pour commencer une nouvelle vie à bord d’un transformable construit par le chantier Braquavacque. Les deux complices choisirent une devise qui reflétait parfaitement leur état d’esprit du moment : le bateau s’appellerait “J’ose”. A cette époque, on pouvait encore obtenir d’un chantier qu’il construisit une péniche non-motorisée, mais la progression inéluctable du nombre des automoteurs annonçait la disparition du transport tractionné. Les bateaux de fer coûtaient cher et pour toucher le vaste marché des artisans mariniers sans ressources, les constructeurs avaient imaginé une variante économique, une unité aux normes Freycinet en tous points semblable au croiseur de canal moderne à ceci près que le progrès technologique qui faisait toute la différence n’y était pas présent. Le transformable, frère jumeau de l’automoteur, était dépourvu de moteur, condamné à suivre ses semblables derrière un remorqueur, à dépendre de la disponibilité d’un tracteur sur berge, à recourir aux services d’un charretier ou, à défaut d’autre solution, à se faire halé à col d’homme par quelque pauvre bougre. Bien sûr, il y avait l’argument commercial que le vendeur assénait quand le luxe du logement avait mis des étoiles dans les yeux de la batelière et que le batelier aussi était presque conquis :
– La salle des machines, l’emplacement du réservoir de carburant, le passage de l’arbre d’hélice, tout est prévu pour l’adaptation future du moteur que vous achèterez avec les bénéfices que cette merveille vous permettra d’empocher !
Bien sûr…
Pour Constant et pour Bon, comme d’ailleurs pour beaucoup de bateliers besogneux, le miracle n’eut pas lieu, l’argent ne se mit pas couler à flot dans le lit des rivières. Les affaires tournèrent mal : la crise faisait rage et les affrètements pourris succédaient aux affrètements pourris.
Constant était à bout de force. Bon l’aidait de tout son possible, mais le directeur de l’institut restait inflexible :
– Pour l’accès au diplôme, on ne peut s’abstenir de fréquenter les cours.
Tout au plus tolérait-il que Bon quittât l’internat en fin de semaine à chaque fois que “J’ose” était dans la région.
Le printemps fut terrible. L’argent manqua. Les traites ne purent être honorées et quand Bon sortit de Saint-Ghislain avec son beau diplôme en poche, le sort de l’entreprise était déjà scellé.
Les contrats d’hypothèques fluviales avaient des clauses d’une injustice terrifiante. A l’époque, le législateur avait commencé à se préoccuper des intérêts des petits commerçants et des agriculteurs, mais il avait omis de prendre en compte les problèmes consécutifs à la révolution industrielle de la navigation qui exigeait des efforts financiers considérables. En cas de défaillance, le batelier perdait tout. La péniche était saisie. Les remboursements effectués n’étaient pas pris en compte et demeuraient dans l’escarcelle du bailleur de fonds qui n’était autre, le plus souvent, que le constructeur lui-même.
S’agissant de la destruction d’une péniche, les bateliers parlent de déchirage ; s’agissant de leur débarquement pour causes économiques, il faudrait dire “déchirement”.
Bon n’oublia jamais les ultimes minutes de sa vie à bord de “J’ose”.
Toute la famille était rassemblée dans la cabine, Constant avait mis son costume noir. Il était assis devant l’huissier qui venait d’ouvrir une mallette de cuir de laquelle il extrayait sa paperasse. Bon, sa mère et ses deux sœurs se tenaient debout, un peu à l’écart.
Constant signa l’acte de saisie après que l’huissier en eut fait lecture d’une voix atone et pressée comme si ce qu’il disait était de l’ordre de l’inavouable.
– Il y a encore quelques menus détails, dit le fossoyeur d’avenir.
Constant restait sans réaction, comme groggy. La mère plongea une main dans la poche de son tablier et s’approcha de la table.
– De quoi voulez-vous parler, mon cher petit monsieur ?
– Il y a encore les agios, chère madame… des frais, cette saisie n’est pas gratuite. Votre contrat stipule bien…
Il n’eut pas le temps d’en dire davantage. La mère venait de poser le Moser 7’63 sur la table.
– Je crois que tout est dit monsieur l’emberlificoteur. Laissez-nous tranquilles avec tout ce blabla qui ne sert à rien d’autre qu’à embobiner les braves gens. Allez dire à monsieur Braquavacque – elle avait mis tout le mépris possible en trainant sur la première syllabe de monsieur – que nous sommes quittes et libres.
L’acier noir du pistolet brillait dans la lumière triste qui filtrait d’un hublot. Dans l’esprit de Constant c’était toute la tristesse de la guerre qui tout à coup resurgissait. Il restait là pétrifié, anesthésié par cet outil de mort. Pour la première fois, la légèreté abandonnait ses traits. Son visage était vide, comme aspiré de l’intérieur par des pensées d’horreur.
Les yeux de Bon allaient de l’arme au visage du père, cherchaient à accrocher son âme à la dérive. La froide menace, le petit jour minable au-delà du hublot, le désespoir du père, la colère sourde de la mère, la sueur sur le front de l’huissier, les émotions palpables de l’instant, tout alla s’enfouir au plus secret de sa mémoire. Le garçon que l’on avait élevé à grands renforts de “pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés” se disposait déjà à tendre l’autre joue de peur qu’on lui reproche de manquer d’indulgence.
Un jour ou l’autre, c’était inévitable, toute cette violence refoulée ressurgirait.
Constant ne vécut encore que quelques années. La mère, plus longtemps.
Bon trouva sans difficulté un travail. Ses qualités de cœur et sa débrouillardise – à bord, il fallait pouvoir mettre la main à tout – en faisait un précieux collaborateur aimé de ces collègues autant que de ses chefs.
Il se choisit une compagne, Jeanne, aussi bonne que lui. Ils eurent quatre beaux enfants. Quand le salaire le permit, ils achetèrent un joli petit terrain en bordure de fleuve – cela va de soi. Ils firent bâtir une maison que Bon paracheva de ses mains.
Jouxtant son petit lopin de bonheur, il y avait une peupleraie, des robustas. Au printemps, les arbres revêtaient une livrée rouge qui virait lentement au vert à mesure que le soleil s’élevait dans le grand ciel derrière le fleuve. Aux jours de juin, les peupliers éjaculaient doucement leur semence dans la petite brise. Le halage en était couvert comme d’un manteau de neige. A l’automne, avant de se raidir sous les assauts du froid, ils offraient aux promeneurs un ultime cadeau. Leurs feuilles, une à une, se détachaient et s’amassaient en un épais tapis qui exhalait à la première pluie une inoubliable odeur capiteuse et sucrée.
Cet endroit était devenu l’incontournable but de promenade de Bon et de son compagnon Zazou, petit cabot hautement sympathique et totalement bâtard, toujours collé aux basques de son maître.
Malgré son caractère inoffensif et sa parfaite bonne humeur ce fut cet animal qui déclencha, bien involontairement, le débordement colérique annoncé.
L’accident survint un soir de juillet. La journée avait été chaude.
Après le travail, Bon était sorti du jardin par le portillon qui donne sur le chemin de halage. Comme toujours, Zazou était à la fête. Il allait et venait plein d’enthousiasme, reniflant ici, arrosant là, se démenant comme un doux dingue dans les jambes de son maître, queue en folie, réclamant sa ration de caresses puis repartant en trombe pour arpenter son territoire.
Bon s’amusait de ces pitreries et flânait rêveusement. Un montant à pleine charge peinait sur la rivière. Il y avait beaucoup d’eau à cause des orages de la veille. Le diesel pulsait sa note têtue que les berges renvoyaient en écho lui conférant un rien de réverbération sonore qui caressait l’oreille. L’esprit de Bon se perdait dans la contemplation de la vague d’étrave, si parfaitement galbée, si émouvante. La rondeur des basses du moteur, le gonflement concupiscent de la rivière et l’embrasement du ciel rendaient l’instant délicieusement grisant.
Un coup de fusil.
– Zazou !
Le cri avait jailli sans qu’il le veuille. Déjà, son regard fouillait anxieusement les alentours. Rien. Personne. Bon était seul sur le chemin. Pris de panique, il se mit à courir vers le petit bois où Zazou avait ses habitudes. Il n’avait pas atteint l’orée que le cabot déboulait à fond de train comme un fraudeur qui vient de voir les gabelous. Bon, soulagé, se mit à lui flatter l’échine pour calmer son émoi.
– Viens là. C’est tout mon Zazou.
– Il est à vous ce bâtard ?
Bon se redresse. Qui parle ? Chapeau vert sur la tête, chemise blanche, bottes, culottes de cheval et fusil cassé sur l’épaule, un homme sort du bois. Bon reconnaît le m’as-tu-vu. Pas de doute, c’est Bertrand Braquavacque, le fils à papa, “un grand capitaine d’industrie” comme se plaisent à dire les gogos boursicoteurs. Il s’est fait construire son petit Versailles ostentatoire près de la coupure. A défaut de grand canal, un ancien bras d’Escaut revu et corrigé, ça en jette quand même. Et puis, il y a le parc et les élevages de faisans. C’est chic, le dimanche, de se tirer son petit gibier depuis la terrasse sans quitter son fauteuil, non ?
Le m’as-tu-vu s’approche, il a l’air essoufflé. On voit qu’il manque d’exercice, il est en nage. Arrivé à la hauteur de Bon, il le toise avec toute l’arrogance dont il dispose. Il dispose de beaucoup d’arrogance !
– Ça fait un moment que je vous ai à l’œil, mon cher ami : vous et votre roquet.
Bon le regarde stupéfait. Où veut-il en venir celui-là avec son “cher ami” ? Zazou et lui seraient-ils des vauriens ? La vie tranquille au bord du fleuve serait-elle devenue un délit, un crime de lèse-parvenu ?
Bon ne dit rien, il se contente d’afficher son presque sourire qui désarme, mais le gaillard ne semble pas disposé à capituler.
– Je vous connais, vous et les autres, vous en voulez à mes faisans. Tous des voleurs !
Quand le mot “voleur” tombe dans l’oreille de Bon, il se produit comme un déclic. Comme le bruit du cran de sureté du Moser qui se déverrouillerait de lui-même. Sa vision tout à coup se brouille. Il revoit l’arme sur la table, l’éclat du métal triste et, dans les yeux de son père, toute la guerre misérable : des hommes ivres de trouille hachent, tranchent, déchiquettent, exterminent d’autres hommes qui cachent la même trouille derrière des masques à gaz qui les font ressembler à des cochons stupides ; un grand bateau de fer survole les tranchées, l’hélice brasse l’air enfumé qui empeste ; dans la timonerie, un grand capitaine d’industrie, bardé de médailles comme des pièces d’or, s’esclaffe : “ Tout est prévu pour le futur. Cette merveille vous fera gagner !” ; sur les écoutilles, pendus à la ligne de vie par des gros mousquetons, un chœur d’huissiers, très dignes, très soucieux de soutenir le moral des trouilles, entonne une improbable Brabançonne : “Cette saisie n’est pas gratui-i-te. Votre contrat stipu-u-le : vous et vo-o-tre chien. Voleur, voleur, voleurs !”
Un claquement inattendu, incongru, comme le coup de tonnerre d’un orage de chaleur.
Le cauchemar s’arrête.
Bon n’en croit pas ses yeux, sa main vient de frapper la joue de Braquavacque ! Durement, méchamment, avec tellement de force que l’autre vacille et que sa sueur éclabousse. Le fusil tombe sur le sol.
Cet accès inattendu de violence fait basculé l’esprit de Bon. Lui le tout doux, lui le patient, l’homme généreux jamais pris en défaut, voilà qu’il se met à vociférer :
– Vous avez dit voleur. Moi, voleur ? Mon chien, voleur ? Mais Braquavacque, vous vous trompez : le voleur, c’est vous. Avant vous, le voleur, c’était votre père. Il faut bien que quelqu’un vous le dise en face : vous avez les mains sales. Sale type ! Sale voleur ! Sale spoliateur ! Détrousseur, dépeceur, sale vulgaire profiteur…
Bon était livide, ses lèvres bleues, son regard halluciné était vide. Tout le sang avait quitté sa face, c’était un visage mort qui déversait un flot continu d’invectives. L’autre se couvrait de ses mains comme si chaque mot lui tombait dessus comme un crachat.
Jeanne avait entendu le coup de feu. Elle était sortie précipitamment de la cuisine et comprenant que quelque chose tournait mal, avait filé chez le voisin, lui demander d’intervenir.
Gérard avait accouru. Il s’était placé entre Braquavacque et Bon et il parlait tout bas pour tenter de calmer le jeu.
– Cela suffit. Viens Bon, on rentre. Reprends-toi.
Bon avait froncé les sourcils comme s’il tentait de se remémorer quelque chose. Son regard s’était réveillé et il avait lu le message sur les lèvres de Gérard comme il le faisait à l’institut de Saint-Ghislain. Après cela, son incontournable sourire était réapparu.
– C’est toi, Gérard. Comment vas-tu ? Oui, tu as raison. Je crois qu’il vaut mieux que nous rentrions.
Braquavacque avait déguerpi sans demander son reste.
Rentré chez lui, Bon était resté longtemps dans la bergère près de la fenêtre à regarder du côté du fleuve. Une péniche passait. Sur les écoutilles le batelier avait installé une sorte de cage où s’ébattait un tout petit enfant.
Bon cherchait encore à se reprendre. On entendait le froissement de l’air que ses poumons gobaient avec toute la peine du monde. On avait mal pour lui.

 Bonjour a tous ; Bon, rien d'autre a dire , c'est beau . Bravo
Bonjour a tous ; Bon, rien d'autre a dire , c'est beau . Bravo